Les langues sifflées
Des populations du monde entier utilisent des formes complémentaires de la langue qu'on appelle "langues sifflées" ou plus justement "paroles sifflées" car elles utilisent les modulations du sifflement à la place de celles des vibrations des cordes vocales. Elles constituent une forme sifflée de la langue parlée car elles en ont la complexité en termes de syntaxe et de vocabulaire. Elles permettent des communications à plus grande distance que la voix parlée par exemple dans les Pyrénées (autrefois), les îles Canaries ou en Turquie. Elles permettent de se fondre dans les bruits de la forêt pour organiser la chasse comme en Amazonie, elles servent aussi à tenir des conversations amoureuses comme en Asie du sud est (populations Hmong par exemple).
Ecoutez quelques extraits sonores:
La manière de transposer et copier la voix parlée en sifflements est à chaque fois adaptée à la structure de la langue concernée. Elle est aussi adaptée à la complexité des dialogues utilisés sous cette forme dans chaque culture. Par conséquent, la possibilité de rendre hautement intelligible les imitations sifflées de la paro le pour des phrases compliquées dépend du cadre sociolinguistique et phonétique. En turc et en español par exemple, tout pourrait être dit, y compris lire le journal à un interlocuteur. En akha, ce sont plutot des phrases poétiques tirée de la tradition orale récitée qui sont transposées.
Le phénomène des langues sifflées
Les langues sifflées sont souvent malheureusement menacées comme la culture des peuples qui les parlent. Pourtant elles détiennent des informations vivantes sur le langage humain.
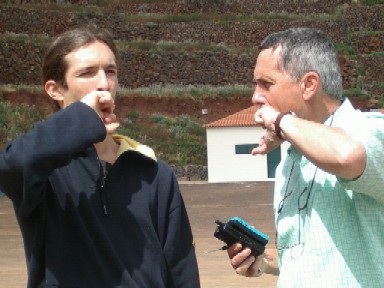 Tout peut se dire en langue sifflée c omme en langue parlée et comme en atteste cet extrait de silbo (espagnol sifflé de l'île de La Gomera aux Canaries) :
Tout peut se dire en langue sifflée c omme en langue parlée et comme en atteste cet extrait de silbo (espagnol sifflé de l'île de La Gomera aux Canaries) :
|
et qui signifit:
|
Leur technique de sifflement est héritée des guanches (berbères) qui vivaient sur l'île avant l'arrivée des espagnols. Nous en avons répertorié à l'heure actuelle une cinquantaine citées ou bien dans les documents auxquels j'ai eu accès (certaines ont peut être disparu depuis), ou bien par des contacts directs. Elles sont réparties partout à travers le monde et représentent une grande diversité linguistique. La technique de sifflement ne fait pas intervenir les cordes vocales contrairement aux langues parlées mais l'intensité du sifflement modulée par la forme de la bouche qui pour chaque voyelle se rapproche de la forme dans la langue parlée. |
 Voici la langue, un, deux doigts, une feuille rigide ou rien appuyant dessus . Les lèvres restent absolument fixes, rigides et recouvrent les dents. L'impédance acoustique des lèvres ne varie pas. Par contre, les deux tiers postérieurs de la langue peuvent s'élever ou s'abaisser variant ainsi le volume de la cavité buccale et sa résonance avec le possibilité de l'accorder (dessin d'après une radiographie, André Classe). Voici la langue, un, deux doigts, une feuille rigide ou rien appuyant dessus . Les lèvres restent absolument fixes, rigides et recouvrent les dents. L'impédance acoustique des lèvres ne varie pas. Par contre, les deux tiers postérieurs de la langue peuvent s'élever ou s'abaisser variant ainsi le volume de la cavité buccale et sa résonance avec le possibilité de l'accorder (dessin d'après une radiographie, André Classe). |
 On peut réduire le modèle à un schéma où l'ouverture A représente les lèvres fixes et la partie bombée B représente la position de la langue (dessin de André Classe). On peut réduire le modèle à un schéma où l'ouverture A représente les lèvres fixes et la partie bombée B représente la position de la langue (dessin de André Classe). |
 Le siffleur crée ainsi une situation proche mais non analogue à celle du syrinx des oiseaux. Le siffleur crée ainsi une situation proche mais non analogue à celle du syrinx des oiseaux. |
 Le signal produit est une voyelle continue ou entrecoupée de pauses qui forment des prémisses de consonnes. Les premiers observateurs plaçaient les mélodies sur des portées. Cette portée a été écrite en 1934 par I. Dugast chez les Banen du Cameroun. Le signal produit est une voyelle continue ou entrecoupée de pauses qui forment des prémisses de consonnes. Les premiers observateurs plaçaient les mélodies sur des portées. Cette portée a été écrite en 1934 par I. Dugast chez les Banen du Cameroun. |
 Aujourd'hui on peut observer la fréquence du signal (sonagrammede langue sifflée pyrénéennes avec au dessus le diagramme du niveau en fonction du temps par le Pr. Busnel) ; on peut aussi replacer le signal d'origine sur une portée tout en gardant la forme initiale comme sur la figure où l'on distingue bien les voyelles des consonnes. Aujourd'hui on peut observer la fréquence du signal (sonagrammede langue sifflée pyrénéennes avec au dessus le diagramme du niveau en fonction du temps par le Pr. Busnel) ; on peut aussi replacer le signal d'origine sur une portée tout en gardant la forme initiale comme sur la figure où l'on distingue bien les voyelles des consonnes. |
 Sur ce shéma, est représenté l'articulation de la angue sifflée des canaries. Il y a interruption quand la langue touche le palais. (A. Classe) Sur ce shéma, est représenté l'articulation de la angue sifflée des canaries. Il y a interruption quand la langue touche le palais. (A. Classe) |
Diversité des langues sifflées
On distingue plusieurs types de langages sifflés : ceux pour les langues à dominante tonale (langues à ton comme le chinois : langues sifflées Mazateco du Mexique, langue sifflée Akha ou Hmong d'Asie du Sud Est, ou Banen du Cameroun), dans ce cas le sifflement des tons portés par les voyelles est la partie la plus importante ; et ceux pour les langues non tonales comme le silbo (ci dessus) ou le bearnais ossalien des Pyrénées dont la technique et le décodage s'appuie sur des voyelles sifflées à différentes fréquences qui dépendent de l'articulation. Il existe un troisième type de langages sifflés qui est une recherche d'équilibre entre les deux stratégies précédentes, ce sont ceux s'appuyant sur des langues ayant un statut intermédiaire : langues tonales avec peu de tons (comme le Surui d'Amazonie (voir Meyer 2005)) ou langues sans tons pour lesquelles le timbre et l'intonation de la voyelle jouent tous les deux un rôle important.
Usage
Elles permettent des communications à plus grande distance que les langues parlées (comme à Kuskoy en Turquie) ou bien en se fondant dans les bruits de la forêt pour la chasse (comme en Guyane ou au Brésil) ou pour des rendez-vous amoureux secrets (chez les Kickapoo au Mexique). Elles interviennent aussi dans les rites religieux et tous les moments forts de la vie. Elles cumulent ainsi les rôles sociaux dévolus au langage et à la musique.
Allez voir aussi les publications scientifiques.





